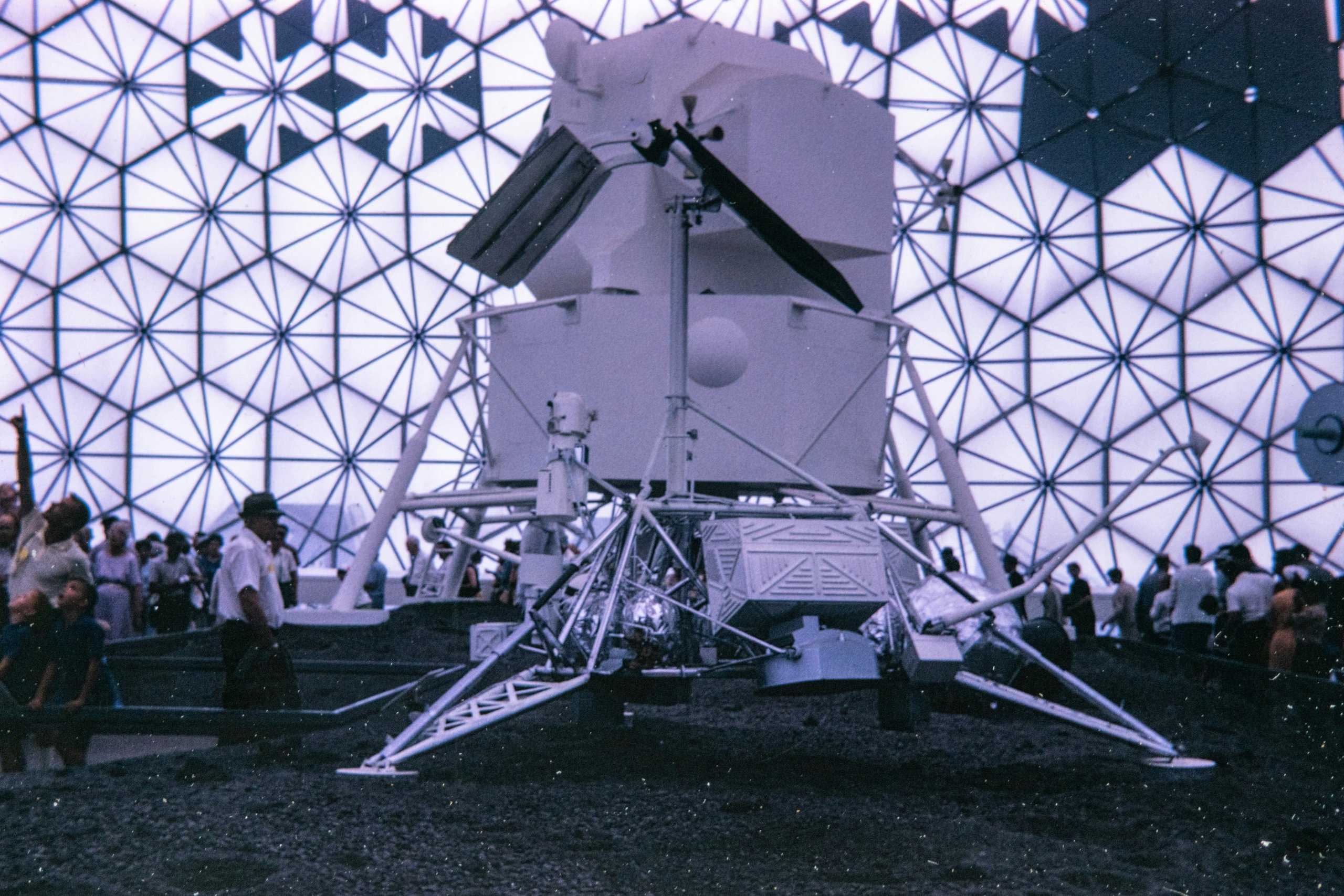Lorsqu’on évoque la lutte pour l’indépendance du Burundi, les noms de Rwagasore, Ngendandumwe ou Mirerekano reviennent naturellement. Ces grandes figures des années 1950-60 ont incarné une résistance politique organisée, structurée, visible. Mais bien avant eux, dans l’ombre de l’histoire officielle, d’autres voix s’étaient levées. Plus mystérieuses, plus spirituelles, souvent oubliées. Ce sont celles de devins, de visionnaires, de personnages à mi-chemin entre chef religieux, leader populaire et agitateur politique.
Ils n’avaient ni partis, ni journaux, ni microphones. Mais ils avaient la parole, les symboles, et surtout : l’écoute du peuple. À travers leurs récits, on découvre une autre forme de résistance, enracinée dans les croyances, les peurs, mais aussi dans l’espoir d’un avenir affranchi du joug colonial. Voici l’histoire de quatre d’entre eux.
Gisesarubere, l’imposteur devenu légend
Nous sommes en 1909, un an après la mort du roi Mwezi Gisabo. Un homme venu de Tanzanie, du nom de Maziguru, arrive dans la région de Munyinya (commune de Gisuru, Ruyigi). Il ne se présente pas comme simple voyageur. Non. Il prétend être roi. Et le peuple le croit.
Il introduit une variété de sorgho blanc, importée de sa terre natale, Buha. La récolte est abondante, presque miraculeuse. On le surnomme alors Gisesarubere, « celui qui a apporté le sorgho blanc ». Il gagne en popularité. Mais très vite, l’homme franchit la ligne : il commence à tuer les voyageurs de passage, des soldats allemands pour la plupart.
Les colons allemands, furieux, accusent le prince Kiraranganya, chef de la région, de complicité. Il est arrêté et envoyé à Usumbura (l’actuelle Bujumbura). Mais ses partisans n’acceptent pas cette injustice. Dans un acte spectaculaire de vengeance et de loyauté, ils tuent Gisesarubere, placent sa tête dans une jarre, et l’envoient aux autorités coloniales.
Kiraranganya est libéré. Gisesarubere, lui, disparaît comme il est venu : entre mythe et violence, acclamé puis éliminé.
Runyota Kanyarufunzo, le prophète des plaines rebelles
Quelques années plus tard, en 1922, un autre devin entre en scène. Il s’appelle Ntirwihisha, mais on le connaît sous les noms de Runyota ou Kanyarufunzo. Originaire de Kagombe, près de Gitega, il surgit dans un contexte d’instabilité : le prince Ntarugera vient de mourir, et ses héritiers rechignent à gouverner.
Runyota en profite. Il rejette les vêtements européens, s’habille d’une peau de chèvre, laisse pousser ses cheveux et appelle à la révolte contre les chefs locaux et les impôts belges. Il devient la voix de ceux qui refusent l’ordre colonial, le symbole d’un rejet profond.
Au début, les colons rient. Puis vient Pequet, un administrateur belge venu évaluer la situation sur place. Il est attaqué à la lance, mais en réchappe. Le signal d’alarme est donné.
Les Belges passent à l’offensive. Des troupes sont envoyées dans les régions de Mishiha, Gitega et Muyinga. Runyota, lui, promet à ses partisans que les balles se transformeront en pluie. Mais la pluie ne vient pas. Seul le sang coule.
Après trois mois de combats, il est capturé, pendu, puis jeté dans une rivière. Mais son message avait déjà fait des vagues. D’autres allaient suivre.
Inamujandi wa Jambo, la voix féminine de la rébellion
Fin 1934. Une femme, Inamujandi, devineresse de Ndora (Cibitoke), affirme avoir eu une vision : un roi surnaturel est né. Il ressuscite les morts, arrête les balles, envoie les animaux sauvages punir les récalcitrants. À cette époque, une terrible famine frappe le pays, causée par une invasion de criquets. La population est affaiblie, désespérée. Elle écoute.
Le 23 juillet, ses partisans passent à l’action. Ils attaquent les chefs locaux, brûlent leurs maisons, pillent leur bétail. La réaction coloniale est immédiate. Le gouverneur du Rwanda-Urundi envoie 50 soldats depuis Musigati et Ngozi.
Malgré une résistance acharnée de trois mois, Inamujandi est capturée. Mais dans les collines, dans les murmures, son nom résonne encore comme celui d’une femme qui a osé.
Pawuda, le roi qui n’était pas roi
Dernier épisode de cette série de rébellions mystiques : Pawuda, de son vrai nom Pascal. En 1944, il déclare être le fils caché du roi Mwambutsa, envoyé pour libérer le Burundi.
Il s’appuie sur des révélations d’un devin tanzanien. Son message prend. À Giharo et Kumoso, on l’accueille comme un sauveur. Le peuple espère une délivrance, car les Belges exploitent durement la population pour soutenir l’effort de guerre européen.
Mais les chefs traditionnels, eux, voient une menace directe. L’un d’eux, Ndenzako, alerte l’administration. Pawuda est arrêté, jugé, et condamné à cinq ans de prison. Le chef de Kumoso, qui l’avait soutenu, est destitué.
Des résistances effacées mais fondatrices
Ces devins n’avaient ni armée, ni diplomatie. Leur pouvoir résidait dans la parole, le mystique, la foi populaire. Leurs rébellions ont toutes été réprimées, parfois violemment. Mais elles ont laissé une empreinte. Une idée. Celle que le pouvoir colonial pouvait être contesté, remis en question, même au péril de la vie.
Inamujandi, Runyota, Gisesarubere, Pawuda… Ils ont ouvert la voie. Leur combat, souvent qualifié de « désordonné » ou « primitif » par les colons, était en réalité une première secousse. Une résistance enracinée, instinctive, avant l’arrivée du discours politique moderne.
Il est temps de les sortir de l’oubli.
Voir podcast: